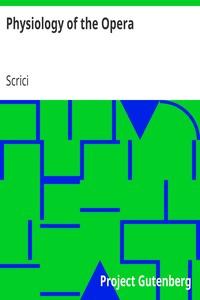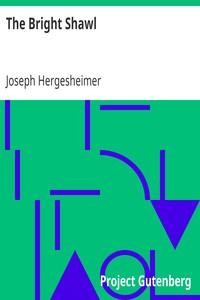Read this ebook for free! No credit card needed, absolutely nothing to pay.
Words: 130510 in 11 pages
This is an ebook sharing website. You can read the uploaded ebooks for free here. No credit cards needed, nothing to pay. If you want to own a digital copy of the ebook, or want to read offline with your favorite ebook-reader, then you can choose to buy and download the ebook.
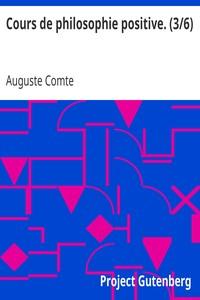

: Cours de philosophie positive. (3/6) by Comte Auguste - Positivism FR Philosophie Religion et Morale
constitue la plus admirable de ces belles d?couvertes qui ont caract?ris? les premiers pas de la chimie moderne, non-seulement en vertu de l'?clatante lumi?re que cette analyse a r?pandue sur l'ensemble des ph?nom?nes chimiques et sur l'?conomie g?n?rale de la nature, mais aussi ? raison des hautes difficult?s qu'elle devait n?cessairement pr?senter. Sous ce premier point de vue, la science chimique ne laisse aujourd'hui rien d'essentiel ? d?sirer. Toutefois, la notion, acquise dans ces derniers temps, de l'existence d'une nouvelle combinaison plus oxig?n?e entre les deux ?l?mens de l'eau, tend ? soulever des questions int?ressantes et encore ind?cises, non sur l'irr?vocable composition de ce fluide, mais sur le genre d'influence chimique qu'on suppose ordinairement ? sa d?composition et ? sa recomposition dans une foule de ph?nom?nes; et plus sp?cialement, sur le v?ritable mode d'union de l'oxig?ne et l'hydrog?ne dans toutes les substances, surtout liquides, qui ne peuvent ?tre obtenues sans eau, et ? l'?gard desquelles un habile chimiste vient, tout r?cemment, d'?lever des doutes ing?nieux, qui m?riteraient, ce me semble, d'?tre m?rement examin?s.
L'action dissolvante de l'eau a ?t? le sujet d'une longue suite de laborieuses recherches, d'une difficult? tr?s inf?rieure, et qui, naturellement, ne sauraient pr?senter aujourd'hui d'importantes lacunes. N?anmoins, il faut remarquer, ? ce sujet, avec plus de soin qu'on n'a coutume de le faire, la belle exp?rience de Vauquelin, dans laquelle cet illustre et scrupuleux chimiste a montr? que l'eau, satur?e d'un sel, restait susceptible de se charger d'un autre, et acquerrait m?me ainsi la singuli?re propri?t? de dissoudre une nouvelle quantit? du premier. Cette exp?rience, qui a ?t?, pour ainsi dire, d?daign?e, me semble capitale en ce genre, et me para?t devoir devenir la base d'une suite de recherches fort int?ressantes sur les lois, si capricieuses en apparence, de la solubilit?, dont l'?tude est encore essentiellement empirique.
Apr?s m'?tre efforc?, dans cette le?on, de caract?riser suffisamment, quoique par une discussion sommaire, le but et l'esprit des conceptions fondamentales qui me paraissent indispensables pour investir enfin irr?vocablement la science chimique de la rationnalit? positive qui convient ? sa nature, je dois maintenant passer ? l'examen philosophique plus sp?cial des deux doctrines g?n?rales qui, dans la chimie actuelle, pr?sentent l'aspect le plus syst?matique, et, en premier lieu, appr?cier philosophiquement, dans la le?on suivante, l'importante doctrine des proportions d?finies.
TRENTE-SEPTI?ME LE?ON.
Examen philosophique de la doctrine chimique des proportions d?finies.
Malgr? la grande importance r?elle de cette doctrine, on ne doit pas m?conna?tre que, par sa nature, et m?me en la supposant compl?te, elle ne saurait exercer qu'une influence secondaire sur la solution g?n?rale du vrai probl?me fondamental de la science chimique, tel que je l'ai caract?ris? dans la trente-cinqui?me le?on, c'est-?-dire sur l'?tude des lois directement relatives aux ph?nom?nes de composition et de d?composition. Lorsque des substances quelconques sont plac?es en relation chimique dans des circonstances d?termin?es, la th?orie des proportions d?finies ne tend nullement, en elle-m?me, ? nous faire mieux pr?voir, parmi tous les cas que comporterait la composition des corps propos?s, ? quelles s?parations et ? quelles combinaisons nouvelles la r?action g?n?rale donnera effectivement lieu, ce qui constitue, n?anmoins, la question essentielle. Cette doctrine suppose, au contraire, qu'une telle question est pr?alablement r?solue; et, d'apr?s un tel point de d?part, elle a pour objet d'?valuer imm?diatement, dans les cas o? elle est applicable, la quantit? pr?cise de chacun des nouveaux produits, et l'exacte proportion de leurs ?l?mens, ce qui constitue simplement un perfectionnement accessoire, quoique tr?s utile, de la recherche principale. Ainsi, la th?orie des proportions chimiques pr?sente n?cessairement aujourd'hui ce singulier caract?re scientifique, de rendre rationnelle, dans ses d?tails num?riques, une solution qui, sous son aspect le plus important, reste presque toujours essentiellement empirique.
On con?oit ais?ment par l? pourquoi les illustres fondateurs de la chimie moderne se sont, en g?n?ral, si peu occup?s d'une telle ?tude, qu'ils devaient naturellement regarder comme subalterne. Leur principale attention ?tait justement fix?e sur la recherche directe des lois essentielles de la composition et de la d?composition. Mais, le rapide d?veloppement de la science chimique ayant mis graduellement en ?vidence les hautes difficult?s de ce grand probl?me, les chimistes, sans renoncer ? la d?couverte ult?rieure de ces lois, durent se rejeter spontan?ment de plus en plus sur l'?tude secondaire des proportions, jusque alors n?glig?e, qui, par sa nature, leur promettait un succ?s plus facile et plus prochain. ? la v?rit?, tant que cette th?orie subordonn?e est con?ue isol?ment de la th?orie principale, elle ne saurait, par cela m?me, remplir que tr?s imparfaitement sa plus importante destination, celle de suppl?er, autant que possible, ? l'exp?rience imm?diate, dont elle ne dispense d?s lors que sous le point de vue fort accessoire de la mesure des poids on des volumes. Aussi, la doctrine des proportions d?finies n'acquerra-t-elle toute sa valeur scientifique que lorsqu'elle pourra ?tre enfin rattach?e ? un ensemble satisfaisant de lois vraiment chimiques, dont elle constituera naturellement l'indispensable compl?ment num?rique.
Jusque l?, n?anmoins, l'usage habituel de cette doctrine peut ?videmment offrir aux chimistes un secours r?el, quoique secondaire, en rendant leurs analyses plus faciles et plus pr?cises. Il est m?me incontestable que le principe fondamental de cette th?orie, en restreignant ? un tr?s petit nombre de proportions distinctes les diverses combinaisons des m?mes substances, tend indirectement ? diminuer, en g?n?ral, l'incertitude primitive sur le r?sultat effectif de chaque conflit chimique, puisqu'elle rend beaucoup moindre le nombre des cas logiquement possibles, qui, sans cela, serait presque illimit?. Sous cet aspect, la doctrine des proportions d?finies doit ?tre regard?e comme un pr?liminaire naturel ? l'?tablissement des lois chimiques, dont elle serait, ? d'autres ?gards, un appendice essentiel.
Si les corps pouvaient se combiner, entre certaines limites, suivant toutes les proportions imaginables, il deviendrait, en effet, beaucoup plus difficile de concevoir l'existence de lois invariables et rigoureuses relatives ? la composition ou ? la d?composition, vu l'infinie vari?t? des produits auxquels une r?action quelconque pourrait alors donner lieu. Ainsi, les illustres chimistes contemporains qui ont principalement consacr? leurs travaux ? fonder la th?orie g?n?rale des proportions chimiques, tout en paraissant s'?carter du v?ritable but caract?ristique de la science qu'ils cultivent, auront fait n?anmoins, en r?alit?, un pas essentiel dans la voie directe du perfectionnement rationnel, en simplifiant d'avance, ? un haut degr?, l'ensemble du probl?me chimique, dont la solution effective est r?serv?e ? leurs successeurs. Outre cette importante consid?ration, j'ai d?j? remarqu?, dans l'avant-derni?re le?on, que la doctrine actuelle des proportions d?finies nous offre aujourd'hui, par sa nature, le type le plus parfait du genre pr?cis de rationnalit? que doit acqu?rir un jour la science chimique, directement envisag?e sous ses aspects les plus essentiels. Tels sont les deux motifs pr?pond?rans, l'un relatif ? la doctrine, l'autre ? la m?thode, qui m'ont d?termin? ? consacrer, dans cet ouvrage, une le?on sp?ciale ? l'examen philosophique de cette int?ressante th?orie, sans exag?rer n?anmoins sa vraie valeur scientifique.
Apr?s avoir ainsi caract?ris? sommairement le v?ritable objet de la doctrine des proportions d?finies, et sa relation g?n?rale avec le syst?me total de la science chimique, il est indispensable, pour faciliter son appr?ciation philosophique, de jeter d'abord un coup d'oeil rapide mais rationnel sur l'ensemble de son d?veloppement effectif, accompli tout entier dans le premier quart du si?cle actuel.
Dans cette belle s?rie de recherches, l'impulsion primitive est essentiellement r?sult?e de la double influence n?cessaire, d'un ph?nom?ne fondamental d?couvert par Richter, et d'une indispensable discussion sp?culative ?tablie par Berthollet. Arr?tons un moment notre attention sur ce double point de d?part.
Telle est donc la double influence fondamentale, exp?rimentale et sp?culative, d'o? devait graduellement r?sulter le d?veloppement naturel de la chimie num?rique. ? partir de cette origine, la principale phase de ce d?veloppement doit ?tre attribu?e ? une autre double action capitale, produite par l'harmonie remarquable de la conception syst?matique de M. Dalton avec l'ensemble des belles s?ries de recherches exp?rimentales de MM. Berz?lius, Gay-Lussac, et Wollaston. Il me reste maintenant ? caract?riser sommairement ces diverses parties essentielles de la grande op?ration scientifique qui a d?termin? l'enti?re formation de la doctrine des proportions d?finies, telle qu'on la con?oit aujourd'hui.
Free books android app tbrJar TBR JAR Read Free books online gutenberg
More posts by @FreeBooks

: Cours de philosophie positive. (1/6) by Comte Auguste - Positivism FR Philosophie Religion et Morale